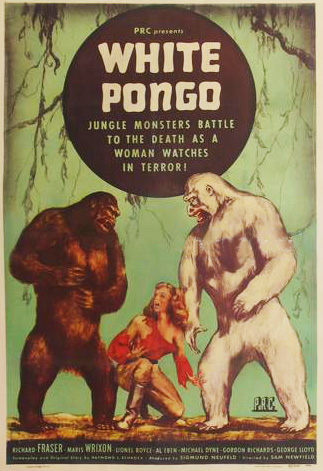Suite du décryptage du débat d’Oxford, épisode fameux de l’histoire heurtée du darwinisme qui mit aux prises, le samedi 30 juin 1860, l’évêque d’Oxford Samuel Wilberforce et Thomas Henry Huxley, fidèle de Charles Darwin. La première partie corrigeait quelque peu la légende, la seconde complète le rôle joué par Huxley.
Tweeter
Seconde partie : Thomas Henry Huxley, profession bateleur
Quel que soit son rôle ponctuel à Oxford, Huxley, le « bull-dog de Darwin » s’est bien trouvé au cœur de la tourmente à d’autres occasions. Il fut parfois dépeint comme un énergique « bouffeur de corbeaux », une description peut-être un peu sommaire, mais non dénuée de sens tant il est vrai qu’il mit sa pugnacité au service du combat darwinien contre des ecclésiastiques à plusieurs reprises. A la suite de deux conférences à Édimbourg, Darwin lui écrira: « Par Jupiter ! Vous avez attaqué la bigoterie dans sa forteresse. » [1]
Huxley ne ménagea pas sa peine. C’est lui, notamment, qui, à l’occasion d’un voyage de cinq semaines, partit porter la bonne parole aux États-Unis. Corinne Cohen donne ce portrait de Huxley en bateleur du darwinisme, qui résume bien sa contribution à la lutte pour l’avancée de l’évolutionnisme :
« Omniprésent sur la scène scientifique et publique anglaise, membre de toutes les académies, faisant des communications devant des savants comme des conférences devant des ouvriers, c’est un brillant orateur et un redoutable polémiste. »[2]
Pour son rôle et ses ambiguïtés, le bull-dog de Darwin est certainement l’une des figures clés pour comprendre les problèmes du darwinisme. Il serait très hâtif de faire de lui un darwinien strict. Il est d’abord réfractaire à l’évolution, même en 1858, lorsque Wallace et Darwin copublient leurs premiers résultats. S’il est convaincu à la lecture de L’Origine des espèces, il fait par contre partie de ceux qui n’ont pas compris que la sélection naturelle était une évidence logique, comme d’autres partisans de Darwin.[3] Il entre également dans ses motivations personnelles une part de ce que l’on appellerait aujourd’hui une volonté de revanche sur le destin, la condition sociale de Huxley étant moins élevée que celle de ses confrères. Dans les années qui suivent la publication de L’Origine des espèces, Huxley soutient l’évolution, mais « plus en paroles (abondantes) qu’en actes (rares) – si l’on entend par là de réels écrits scientifiques. »[4]
A propos de gorilles et d’hippocampes
Huxley eut également une vive querelle avec le grand anatomiste sir Richard Owen (1804–1892), ci-dessous posant avec des ossements de moa :
A l’époque, nombreux sont ceux « qui pensent que le développement tout à fait singulier du cerveau d’Homo sapiens le met à part de tous les mammifères. »[5] Richard Owen en fait partie. Il a d’abord combattu l’idée d’un lien entre hommes et singes dans une polémique avec les lamarckiens dans les années 1840 (ce qui, incidemment, prouve bien qu’on n’a pas attendu les travaux de Darwin pour se formaliser du compagnonnage de l’homme avec les singes). En 1858, il repart à la charge et tente d’établir la spécificité humaine en affirmant que l’une des petites circonvolutions du cerveau, l’hippocampe mineur, n’existe ni chez les chimpanzés ni chez les gorilles, ni chez les autres animaux. Nouvel assaut au congrès de la British Association de 1860, soit quelques jours avant la controverse entre Huxley et Wilberforce… Huxley avait déjà fait part de son opposition aux thèses d’Owen, et ce avant même la publication de L’Origine des espèces. Au congrès d’Oxford, il « contredit ouvertement ce dernier, promettant de publier ses objections dès que possible »[6]. Ce qu’il fait dans un article de 1861 puis dans La place de l’homme dans la nature, en 1863. Il dissèque des primates pour la préparation de son ouvrage et parvient à invalider l’hypothèse d’Owen : tous les singes possèdent un hippocampe (l’inverse n’est pas vrai !). Il intervient bien un changement dans la structure cérébrale des primates, mais il se situe entre les prosimiens (les lémuriens et les tarsiers) et les autres primates, et non entre l’homme et les grands singes. La place de l’homme dans la nature aborde de front la similitude entre l’homme et le singe, contrairement à L’Origine des espèces. Huxley présente son argument de la façon suivante :
« Les différences de structure entre l’homme et les primates qui s’en rapprochent le plus ne sont pas plus grandes que celles qui existent entre ces derniers et les autres membres de l’ordre des primates. En sorte que si l’on a quelques raisons pour croire que tous les primates, l’homme excepté, proviennent d’une seule et même souche primitive, il n’y a rien dans la structure de l’homme qui appuie la conclusion qu’il a eu une origine différente. »[7]
Dans l’édition française, après avoir balayé les critiques qui lui ont été faites durant les cinq années qui ont suivi la parution de l’édition anglaise, il enfonce le clou :
« En résumé, je tiens maintenant pour démontré que les différences anatomiques du ouistiti et du chimpanzé sont beaucoup plus grandes que celles du chimpanzé et de l’homme. De sorte que si des causes naturelles quelconques ont suffi pour faire évoluer (to evolve) un même type de souche, ici en ouistiti, là en chimpanzé, ces mêmes causes ont été suffisantes pour, de la même souche, faire évoluer (to evolve) l’homme. »[8]
Huxley démontre ainsi qu’il n’y a pas de différences physiques entre hommes et grands singes. Mais il ne s’intéresse pas aux mécanismes qui permettent de passer de l’un à l’autre : « Quant à la question de savoir si les causes naturelles peuvent ou non produire ces transformations, je ne m’en mêle pas, satisfait de la laisser aux mains puissantes de M. Darwin. »[9] Il se contente d’une métaphore, celle du « gouffre » entre le singe et l’homme, « qui n’interdit pas qu’il y ait ou qu’il y ait eu une route de l’un à l’autre, dans l’ignorance de laquelle nous sommes. »
Guerre du gorille VS. débat d’Oxford
Toute l’Angleterre a assisté à la bataille entre ses deux grands anatomistes, Owen et Huxley, à propos de ce petit renflement du cerveau. A l’époque de leur vif échange à Oxford, la presse a consacré de longs articles humoristiques à la querelle. Le magazine Punch s’est même fendu de poèmes satiriques. Incontestablement, cette guerre du gorille a plus retenu l’attention que la joute qui allait suivre entre Wilberforce et Huxley.
Ainsi, il y eut bien un « célèbre débat d’Oxford », mais pas celui que l’on a retenu ! Le sens était toutefois le même : le refus d’accepter notre appartenance à la nature et la quête inlassable d’un élément permettant de prouver notre différence, en particulier avec les singes, étaient à l’origine des réticences à l’évolutionnisme. Avec la défaite d’Owen, l’argument anatomique perdait la faveur des hommes de science, mais la recherche d’un particularisme évolutionniste de l’espèce humaine n’était pas près de s’éteindre. Alfred Wallace lui-même, qui en un sens allait plus loin que Darwin en voyant dans la sélection naturelle l’unique moteur de l’évolution, considérera toujours le cerveau humain comme une exception (et sombrera dans le spiritualisme).
En 1864, Benjamin Disraeli fut invité par Wilberforce au Théâtre d’Oxford pour y dénoncer le matérialisme. Il fit, non sans malice, référence au débat qui avait opposé son hôte à Huxley en s’exclamant :
« Quelle est la question que l’on soumet désormais à la société avec une désinvolte assurance des plus stupéfiantes ? La voici : l’homme est-il un singe ou un ange ? Mon Seigneur, je suis du côté des anges. »
La phrase est restée célèbre. Elle démontrait que la bataille autour du singe était bel et bien sortie du cénacle des seuls scientifiques. Peut-être l’ardeur au combat de Thomas Huxley avait-elle permis de faire avancer la cause de l’évolutionnisme sur le plan de la notoriété. Sans doute aussi avait-elle, malheureusement, permis à l’antidarwinisme de se placer clairement sur le terrain de la lutte entre science et religion. Une des sempiternelles fausses questions du créationnisme est formulée ainsi : « Si l’Homme descend du singe, pourquoi reste-t-il des singes ? » C’est ce que Pascal Picq appelle un parfait exemple de « la fallacieuse rhétorique wilberforcienne »[10] (auquel il rétorque ceci : « Imaginez que je dise à mes parents : je ne suis pas votre fils parce que vous êtes encore de ce monde ! »). C’est aussi la preuve qu’un héritage comme celui du « célèbre débat d’Oxford » est parfois plus lourd à porter que ne l’indique la légende.
[1] J. Arnould, Requiem pour Darwin, Paris, Salvator, 2009, p.45. [2] C. Cohen, La méthode de Zadig, Paris, Seuil, 2011, p.149. [3] Pour un détail sur les nuances d’adhésion des naturalistes anglais à la thèse de Darwin, voir l’entrée sur le darwinisme anglo-saxon dans P. Tort (Direction), Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, Paris, PUF, 1996, p.867. [4] Id. p.871. [5] P. Tassy, « Le dictionnaire des idées reçues en science », La Recherche, n°412, Octobre 2007 [6] Collectif, Homo sapiens, l’odyssée de l’espèce, Paris, La Recherche / Taillandier, 2005, p. [7] T. H. Huxley, De la place de l’homme dans la nature, Préface de l’auteur pour l’édition française de 1868. [8] Ibid. [9] Ibid. [10] P. Picq, Lucy et l’obscurantisme, Paris, Odile Jacob, 2007, p.135.