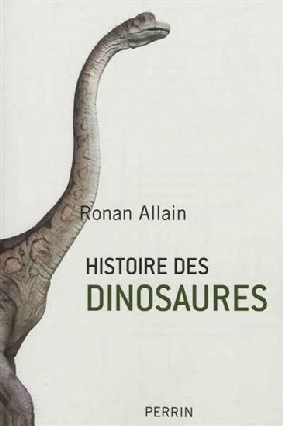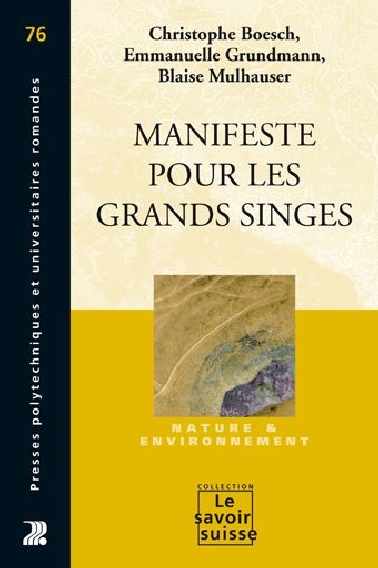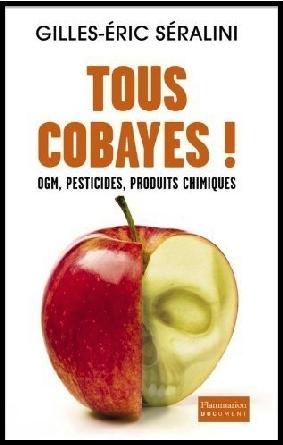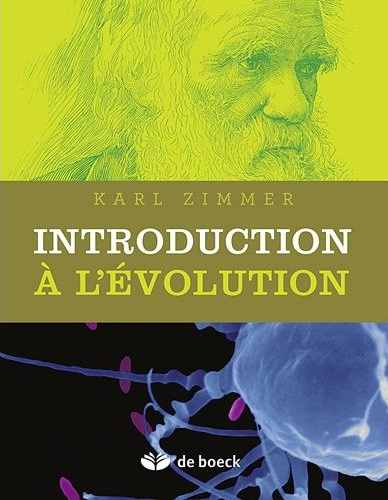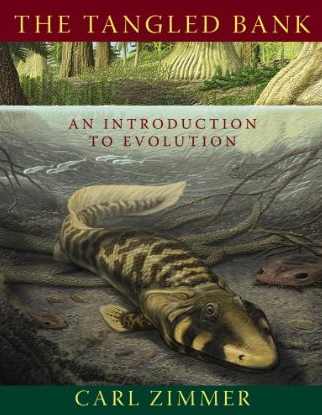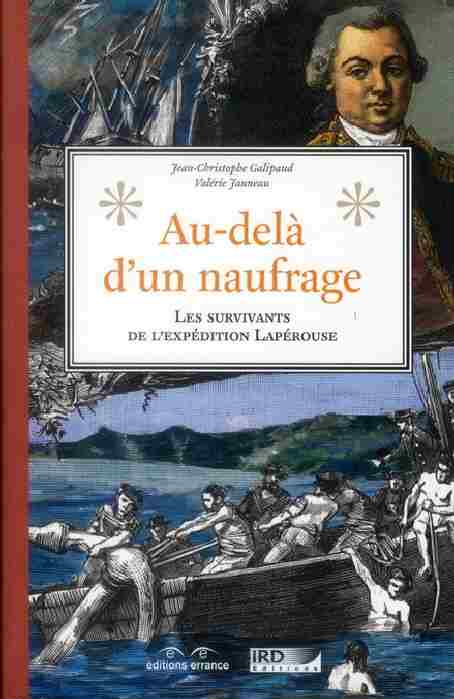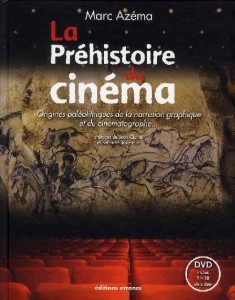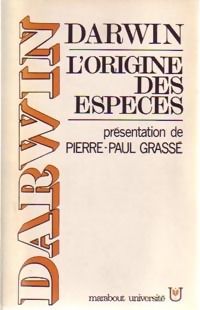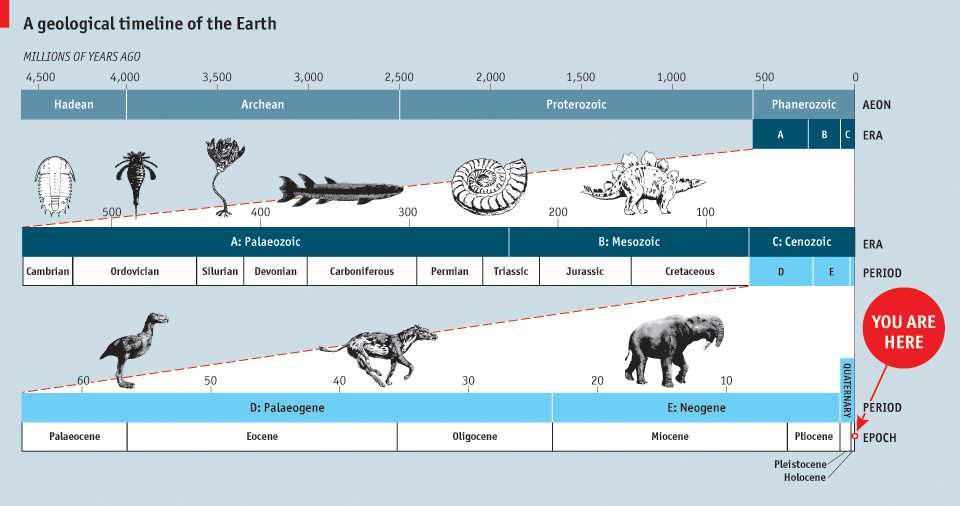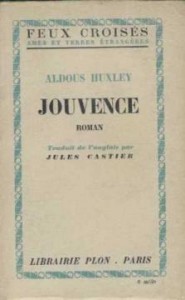Qu’est-ce que l’alterscience ? Une autre science, une science différente, dans l’esprit de ses promoteurs, mais aussi une science altérée, dévoyée, dans laquelle postures, dogmes et idéologies prennent le pas. Qui sont les alterscientifiques ? Des scientifiques professionnels ou, à tout le moins des personnes véritablement formées à la science, ne s’autoproclamant pas simplement scientifiques, qui, à un moment ou un autre et pour divers motifs, basculent en quelque sorte de l’autre côté, évoluant en marge de la science tout en cherchant à s’y inscrire coûte que coûte.
C’est en étudiant les opposants à la théorie de la relativité qu’Alexandre Moatti a commencé à tirer les fils d’un écheveau de théories alterscientifiques qui ne se restreint pas à la physique, mais s’étend aussi à la cosmologie ou aux sciences du vivant. La première partie de l’ouvrage est un examen minutieux de ce qui rassemble les hommes porteurs de ces théories par- delà leurs disciplines et les époques – définissant ainsi ce qui est alterscience et ce qui ne l’est pas. Les invariants sont nombreux. Sur le plan des idées : une théorie (plus ou moins construite, mais l’alterscience ne s’arrête pas à la dénonciation ou au scepticisme et ambitionne d’œuvrer à la construction des connaissances), une attraction – répulsion pour les auteurs de référence (Einstein, Newton, évidemment) qui confine au cas psychiatrique, l’incapacité à saisir les théories récentes faute d’y avoir été formé. Sur le plan des postures : des figures de style récurrentes, la vitupération incessante à l’égard des Académies, une idéologie douteuse qui donne assez prise aux dérives nauséabondes.
Il est remarquable qu’Alexandre Moatti, tout au long de ces portraits d’hommes aussi fascinants que détestables, reste à constante distance sans jamais les réfuter ni les juger, se contentant de les citer et laissant leurs propres paroles opérer contre eux. C’est à peine si, au détour d’une conclusion, il se lâche à ironiser sur ces alter-Galilée des temps modernes autoproclamés, gémissant sur leur sort : « Et pourtant, elle ne tourne pas. » Naturellement, cette manière de faire réclamera un peu d’attention pour ne pas confondre exposé d’une pensée et acquiescement.
Il est particulièrement intéressant de (re)visiter des auteurs des 18e et 19e siècles qui font partie de notre paysage intellectuel sans qu’on sache bien quelles étaient exactement leurs idées – et pour ce qu’Alexandre Moatti nous en livre, il n’est pas certain qu’eux-mêmes l’aient su. Ainsi Saint-Simon, qui n’avait rien compris à la science de son temps ni à Newton, et dont la pensée, sous couvert de tout rapporter à la gravitation, était profondément religieuse. Ainsi Marat, en quête de gloire par l’entremise d’une brève carrière de physicien qui le vit publier des mémoires sur la lumière, sur le feu, sur l’électricité – hélas, c’est dans l’eau qu’il finit par périr. Ainsi Fourier qui emprunte à Newton son nom, mais pas ses idées, se préoccupant de la sexualité des planètes quitte à abandonner toute plausibilité. Ainsi Comte (oui, le père du positivisme), capable de s’enorgueillir de n’avoir pas lu un seul journal depuis 4 ans.
Un autre grand mérite du livre est de constamment resituer cette alterscience dans son contexte historique, alors que l’on a trop fréquemment dans les récits d’histoire des sciences l’impression d’une activité désincarnée. Parce qu’il est beaucoup question d’idéologie, la politique n’est jamais loin. Elle affleure de façon parfois grotesque, à l’occasion d’un discours de Chirac vantant les mérites de Maurice Allais ou d’une lettre de Giscard au créationniste Guy Berthaud (épisodes sans conséquence, mais qui en disent long sur un certain manque de discernement des élites). Plus souvent, elle charrie des relents plus déplaisants : l’antisémitisme semble récurrent (sidérante, cette lettre remplie de haine écrite à Einstein par Le Bon, personnage politiquement inclassable, mais récupéré par Vichy, la Nouvelle Droite ou le Front National) ; les nationalismes instrumentalisent l’alterscience aussi bien que la science (il est marquant que l’antagonisme des nations ait conduit l’immense Haeckel à abandonner sa médaille Darwin lors de l’entrée en guerre en 1914). Toujours sur le plan politique, il est bon de rappeler que l’on trouve, derrière les douces rêveries spatiales d’un Jacques Cheminade, candidat par deux fois à une élection présidentielle dans notre beau pays, les idées bien étranges du « technofasciste » Lyndon Larouche, globalement tues par les journalistes politiques lors de la campagne de 2012. Il est bon de mentionner, aussi, que du côté de « l’ultragauche », l’antiscience n’est pas forcément très éloignée des respectables bacchantes de José Bové, en la personne de certains mouvements rejetant non seulement la technologie en bloc, mais encore le darwinisme. Une position de prime à bord très étrange, mais qui repose sur l’erreur historique ayant consisté à identifier Darwin au darwinisme social et à le ranger du côté du capitalisme (erreur dans laquelle Marx et Engels se fourvoyèrent les premiers). On aboutit ainsi à des considérations aberrantes, taillées dans une forêt de raccourcis, que ne renierait pas Harun Yahya (au sujet de ce dernier, relevons qu’Alexandre Moatti a assisté par deux fois à une intervention publique de son mouvement, ce qui force le respect).
Le soubassement religieux de beaucoup de ces dévoiements de la science donnerait certainement matière à réfléchir aux partisans du dialogue entre science et religion. S’il n’est pas étonnant que la religion soit au centre des oppositions à Darwin, on découvre des prolongements en cosmologie qui ne sont généralement pas mentionnés dans les livres traitant de l’évolutionnisme. Ainsi y eut-il en France en plein 20e siècle, des ingénieurs pour lancer des Cercles d’études centrés sur une théorie géocentrique. Ces ponts ne doivent pas étonner, car dans le petit monde de l’alterscience, on trouve essentiellement tribune auprès d’autres alterscientifiques, quelle que soit leur discipline. C’est pourquoi l’on peut voir notre Georges Salet, polytechnicien et ingénieur du génie maritime, apôtre de l’évolution régressive évoqué ailleurs en ces lieux, intervenir dans les conférences du Cercle de Physique Alexandre Dufour. Il serait intéressant de prolonger l’examen de ces connexions à des cercles plus actuels, quitte à sortir de la définition restrictive de l’alterscience (on peut songer à l’UIP ; aux liens idéologiques entre créationnismes et climatoscepticisme, etc.).
N’allez pas croire que le propos du livre soit si sombre et désespérant qu’il pourrait en avoir l’air. La fréquentation de toute cette tartuferie étalée au grand jour est au contraire réjouissante. On se régale par exemple, de ces suites d’arguments de type « chaudron freudien », consistant à affirmer que la théorie d’untel est fausse tout en avançant qu’elle est de toute façon le fruit d’un plagiat (une variante alterscientifique des bretelles et de la ceinture, d’après le sophisme prêté à Freud : « Je ne t’ai jamais emprunté de chaudron, et d’ailleurs il était déjà percé quand tu me l’as prêté »). Et pour se convaincre, après tout, que ces alterscientifiques ne sont que le produit banal de nos sociétés, on se rappellera que leur plus grande « qualité », ainsi que le rappelle Alexandre Moatti, est ce que Schopenhauer, dans L’Art d’avoir toujours raison, analysait comme « l’obstination à défendre une thèse qui nous semble déjà fausse à nous-même ».
Alterscience – Postures, dogmes, idéologies, de Alexandre Moatti, Odile Jacob, 334 p., 23,90 €
En savoir +:
Casseurs de science, une histoire des malsavants, la critique de l’ouvrage par David Larousserie.